Xavier Jaravel est Professeur d’économie à la London School of Economics (LSE) et membre du Conseil d’Analyse Economique (CAE). Dans cette interview, nous discutons de son nouveau livre intitulé “Marie Curie habite dans le Morbihan” à paraître vendredi prochain aux éditions du Seuil. Dans cet ouvrage, il mobilise les travaux les plus récents de la recherche en économie, dans un style simple et accessible, afin de dresser des constats sur l’innovation et son impact sur les inégalités. Il y propose trois axes afin de dynamiser le processus d’innovation tout en réduisant les inégalités : la politique éducative, l’expansion des marchés, et la gouvernance participative de l’innovation.
Pierre Rousseaux – Pourquoi ce titre ?
XAVIER JARAVEL – Le titre fait référence à un constat central du livre : il existe un large potentiel de talents inexploités, des “Einstein et Marie Curie perdus”. Nous souffrons en France d’un déficit de vocations pour la science, l’innovation et l’entrepreneuriat. Les femmes et les jeunes d’origines modestes se tournent rarement vers de telles carrières, comparé aux hommes d’origines aisées. Ce retard existe même lorsque l’on compare des jeunes avec les mêmes résultats scolaires au lycée. Il y a aussi de fortes inégalités du point de vue territorial : la nouvelle génération d’innovateurs et de scientifiques est très inégalement répartie sur le territoire. Par exemple, le Morbihan est le département avec la plus faible proportion de jeunes se tournant vers les carrières de la science, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, malgré d’excellents résultats scolaires au baccalauréat. D’où le titre de l’ouvrage.
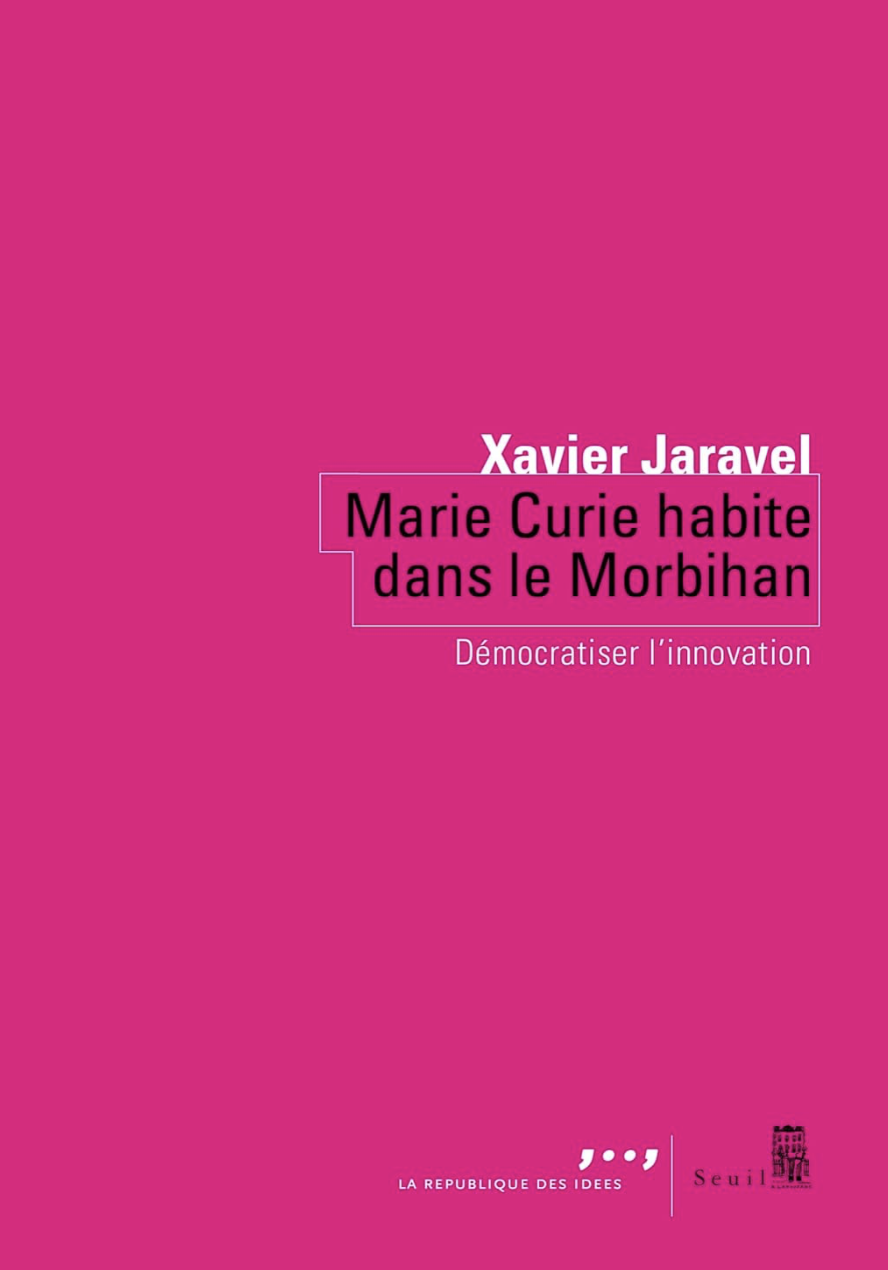
Ces différences s’expliquent par plusieurs raisons, notamment des phénomènes de mimétisme qui sont déterminants dans les choix de carrière. Pour en revenir au Morbihan : l’activité économique y est principalement axée sur l’agriculture et le tourisme, il n’y a pas d’écosystème d’innovation déjà en place et les vocations pour la science et l’innovation émergent donc moins naturellement que lorsque la jeune génération grandit près d’une technopole, par exemple celle de Sophia Antipolis. Le message principal du livre est qu’une meilleure mobilisation des talents – à travers l’éducation et l’orientation scolaire – permettrait de fortement augmenter notre capacité d’innovation et la productivité de l’économie, tout en réduisant les inégalités de genre, intergénérationnelles et territoriales.
Quel constat a-t-il été à l’origine de l’écriture de ce livre ?
Le but du livre est de répondre à la question suivante : la hausse des inégalités est-elle inévitablement un effet collatéral de l’innovation ? C’est une problématique cruciale car nous avons besoin d’innovation sur bien des plans, allant de la transition écologique à la pérennité de notre système de protection sociale (qui dépend fortement de la croissance économique, elle-même tributaire de l’innovation). Intuitivement, on se dit que l’innovation va de pair avec les inégalités : on entend souvent parler des startupers qui lèvent des millions d’euros d’un côté, et de l’autre, de ceux qui perdent leur emploi parce qu’ils ont été remplacés par des robots, peut-être inventés par ces mêmes startupers. Pourtant, le livre conclut qu’il n’y a pas de fatalité : on peut renforcer l’innovation tout en réduisant les inégalités, à condition de choisir les bons axes de politique publique. C’est pourquoi je défends des priorités de politique économique différentes de celles menées aujourd’hui, notamment sur l’éducation, la politique commerciale et la gouvernance de l’innovation.
Pourquoi privilégier l’utilisation des résultats de la recherche en économie pour étayer ces constats et ces problématiques ? De quelle manière ces résultats contribuent-ils à une meilleure compréhension de ces enjeux, et en quoi peuvent-ils guider la mise en place des politiques publiques ?
La recherche moderne en économie, et en particulier les travaux empiriques, permet de dépasser les idéologies et les préjugés pour se concentrer sur les faits et identifier des priorités pour l’action publique. L’analyse des données nous donne de nombreux outils pour identifier des relations de cause à effet, et pas seulement des corrélations. Cela nous permet ensuite de faire des liens directs avec la conception des politiques publiques en identifiant ce qui marche et ce qui a le plus de potentiel.
L’idée est donc de rester proche des travaux de recherche, qui sont d’ailleurs tous cités dans une liste exhaustive des références, disponible en ligne. Le livre rend ces travaux accessibles à tous en les décrivant de manière simple, tout en soulignant leurs limites.
Cela permet à chacun de se forger sa propre vision, car je pense qu’il y a plusieurs interprétations possibles du livre. Certaines idées sont peut-être plus “de gauche”, d’autres peut-être plus “de droite” : on peut s’approprier les idées avancées dans l’ouvrage de différentes manières à partir des faits empiriques, c’est ce que j’entends par “dépasser les idéologies”.
L’observation principale de votre livre est que l’innovation est par principe “en rhizome”. Cependant, bien que l’innovation soit bénéfique en moyenne, ses bénéfices sont répartis de manière très hétérogène.






