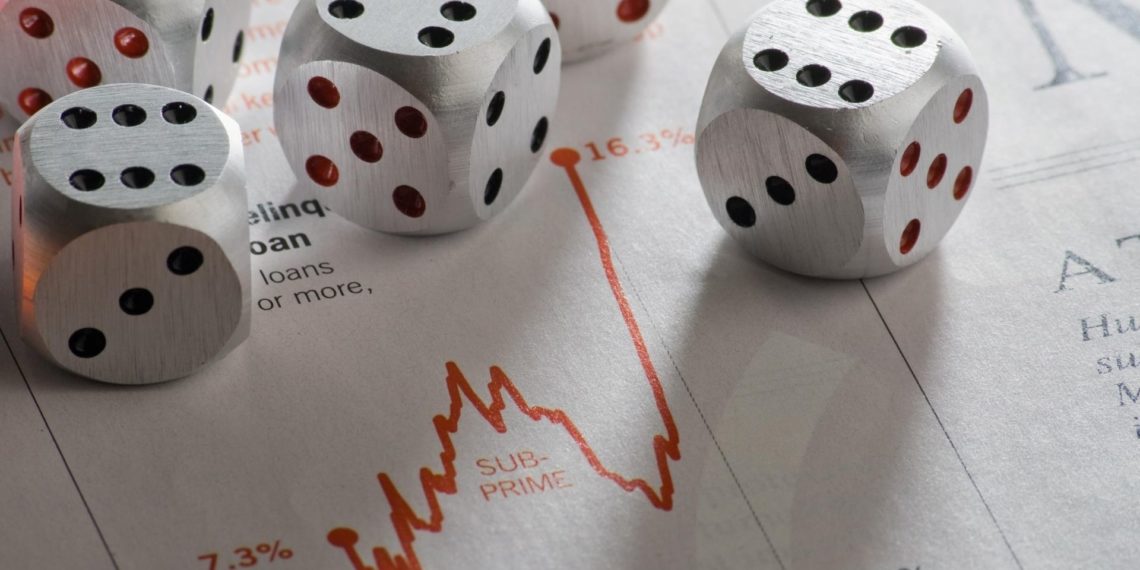Les marchés financiers sont des environnements extrêmement difficiles à comprendre et, à maintes reprises dans l’histoire, ont été à l’origine de chocs qui ont fini par influencer considérablement le cycle économique. Au cours des dernières années, un besoin important de gestion des risques financiers est apparu. Il se concentre sur la détection des différents scénarios financiers et sur la prévision de leur impact sur l’économie réelle et sur les systèmes de production. Dans ce contexte, la croissance à risque (GaR) est un instrument utile pour mesurer comment les perturbations financières influencent le développement de la croissance économique dans des zones comme les États-Unis ou l’UE.
Lieu de rencontre entre les agents en besoin de financement et en capacité de financement, les marchés financiers jouent un grand rôle dans le cycle d’une économie. En effet, en période prospère, chaque produit financier (action, obligation etc.) permet le financement de projets d’investissements tant pour une entreprise qu’un entrepreneur muni d’un projet nouveau. Cette orientation des fonds vers ceux qui en ont besoin (ou uniquement par but de spéculation) permet une retombée positive sur l’économie réelle.
En revanche, en période d’incertitude et de contraction de l’économie, les marchés financiers sont souvent les premiers à surchauffer, chose que l’on a récemment pu constater avec la crise du COVID-19 qui a provoqué un vent de panique bien avant d’en avoir contagié les gouvernements. Baisse des prix des actifs, répercussions sur les emplois, le bien-être en général, les conséquences sont lourdes et durables.
Ainsi, quelque soit l’état de l’économie, les marchés financiers, bien qu’à première vue éloignés, via leurs dématérialisation, sont en réalité un facteur essentiel des dynamiques de l’économie. Si les marchés vont mal, l’économie en souffre, et inversement.
Quand elles se présentent, les crises affectent ce que l’on appelle les conditions financières. Ces dernières sont associées à quatre indicateurs principaux : le dollar américain, les spreads des obligations (écart entre le taux d’intérêt d’un actif sélectionné par rapport à un actif sans risque. Par exemple, pour les obligations d’état, on considère souvent l’obligation allemande comme la plus solide et la moins risquée. Ainsi, plus le spread d’une obligation d’un état est haut (en comparant au taux allemand) et plus cette obligation est risquée. Il faudra donc payer à l’investisseur la valeur du spread en plus que celui de l’actif sans risque (ici l’obligation allemande) pour pouvoir récompenser sa prise de risque), les cours des marchés boursiers et les niveaux des taux d’intérêts.
Ces conditions financières permettent donc de donner la “température” de la situation économique. Ainsi, les décideurs se basent sur ces conditions afin d’évaluer, en analysant l’effet de leurs actions passés sur l’évolution des conditions financières, et réfléchir à la mise oeuvre des futures politiques économiques.
Les politiques monétaires, rôle de la Banque Centrale Européenne par l’usage des taux d’intérêt et du taux de réserves obligatoires (quantité de monnaie en stock dans les banques afin de faire face à tout risque) afin de stabiliser les prix (car cette stabilité impacte profondément l’économie, les emplois…), sont particulièrement attentives à ces conditions financières. Par exemple, la Banque Centrale Européenne va observer les conditions financières et jouer sur ces outils, afin d’augmenter ou diminuer la quantité de monnaie en circulation, pour faire tendre chacun des indicateurs dans une fourchette “acceptable” pour l’économie.
À première vue, le terme taux d’intérêt semble omniprésent, de part sa caractéristique d’outil de mise en oeuvre de la politique monétaire mais également car en connaître son niveau donne une idée de la situation économique : plus ce dernier est bas et plus l’économie cherche à se relancer/soutenir ; plus il est haut, plus l’économie cherche à freiner son expansion.
La Banque Centrale Européenne a développé un Indice des Conditions Monétaires (MCI), basé sur la somme pondérée du taux d’intérêt à court terme et du taux de change. Le taux d’intérêt est, comme expliqué précédemment, du ressort de la BCE, alors que le taux de change est sujet à des facteurs externes (politiques commerciales des pays étrangers par exemple). La pondération va donner plus d’importance à l’un ou l’autre. Si cet indice semble à première vue représentatif des conditions financières, il faut toutefois remarquer que les pondérations sont sujettes à des incertitudes d’estimation, pouvant varier dans le temps ou entre les modèles et le taux de change, qui viennent alors introduire un facteur aléatoire. De plus, les taux d’intérêt à court terme ne reflètent pas pleinement les conditions financières, surtout lorsqu’ils approchent de leur valeur plancher.
Si les conditions financières semblent essentielles pour l’économie et l’évaluation des politiques monétaires, comment les mesure-t-on concrètement ?
Il y a en quelque sorte autant de mesures des conditions financières que d’indicateurs potentiellement intéressants pour expliquer l’impact des marchés financiers sur l’économie réelle. De plus, la construction de cet indicateur varie par sa flexibilité (pas de calculs faits sur la bases d’hypothèses pouvant ne plus tenir lors d’une situation) et sa capacité à le comprendre, dans le sens où il est possible, au-delà d’obtenir un chiffre correspondant à la condition financière, de savoir d’où vient la potentielle variation (à la hausse ou à la baisse) de l’Indice de Conditions Financières (ICF).
Conscient, après la crise des subprimes, de l’importance des marchés financiers sur l’économie réelle, de nombreux indices de conditions financières ont vu le jour. Goldman Sachs ICF, Morgan Stanley ICF ou Bloomberg US ICF font partie des ICF les plus regardés.
L’indépendance des acteurs des politiques monétaires envers ces indices ne leurs permettaient pas forcément d’obtenir les informations souhaitées. Ainsi, de nombreuses Banques Centrales Nationales ont créé leurs propres ICF, on compte parmi ceux-là l’ICF de la Banque de France.
L’Indice de Conditions Financières (ICF) de la Banque de France s’applique à la Zone Euro. La force de cet ICF est en effet que la variation de l’indice d’une période à l’autre peut être décomposée en variations de ses principales composantes, permettant d’identifier précisément les principales composantes déterminant l’amélioration ou la détérioration des conditions financières. Cette dernière caractéristique est extrêmement utile puisqu’elle permet de pouvoir cibler les actions de la Banque Centrale.
La moyenne de cet indicateur étant nul, seule les variations fournissent des informations. En clair, l’ICF est fixé à un niveau donné qui représente la situation qui n’est ni bonne ni mauvaise, une situation neutre. S’interpréteront uniquement les écarts à cette situation. Un ICF négatif signifie une bonne condition financière, alors qu’une valeur positive signifie une mauvaise condition financière. En clair, plus la valeur de l’indice est élevée et plus les conditions financières se durcissent et impactent négativement l’activité économique. L’indice se base sur six facteurs principaux : les taux d’intérêts, le niveau des crédits dans l’économie, le cours des actions, l’incertitude des marchés financiers (modélisée par l’analyse de certains indices comme le NVIX, le News Implied Volatility Index), l’inflation (la hausse durable et générale des prix), et le taux de change.
Ces indices de conditions financières permettent ainsi de quantifier la situation financière afin de rendre possible l’évaluation des politiques monétaires mises en place dans le passé, pour continuer ou ne pas reproduire les erreurs dans le futur.
Plus généralement, cet indice fournit des chiffres permettant d’analyser le passé et le présent, le futur étant du ressort de la projection et de l’anticipation. Pourtant, une question déterminant pour l’action des politiques monétaires est de connaître l’impact d’une évolution des marchés financiers aujourd’hui sur la croissance du PIB de demain, afin de cibler en amont les facteurs qui pénaliserait la croissance de demain. C’est l’idée derrière le concept d’accélérateur financier formulé par l’ancien président de la FED (Federal Reserve Bank), Ben Bernanke.
Un accélérateur financier sort souvent du marché du crédit aux pics des cycles économiques et finit par avoir un impact sur l’économie dans son ensemble. Il peut amplifier à la fois les chocs positifs et négatifs à l’échelle macroéconomique, car la majorité des entreprises et des consommateurs sont extrêmement sensibles aux changements de l’environnement du marché. Le modèle de l’accélérateur financier a été proposé pour aider à expliquer certains phénomènes comme la façon dont même un changement exigu du taux préférentiel pourrait amener les entreprises et les consommateurs à réduire leurs dépenses. C’est également l’une des raisons des mesures de sauvetage, axées sur la stabilisation des marchés du crédit directement via les banques.
Dans le modèle de l’accélérateur financier, le ralentissement du crédit entraîne une «fuite vers la qualité» : cela signifie que les entreprises et les consommateurs les plus faibles sont abandonnés et que le crédit n’est offert qu’aux entreprises plus fortes. Bernanke a utilisé sa connaissance des accélérateurs financiers pour essayer de limiter la douleur et raccourcir le temps que l’économie américaine a subi avec des conditions de crédit strictes. Cette théorie nous donne l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les décisions de politique monétaire nécessitent une évaluation préalable des différents scénarios économiques, y compris les plus extrêmes. Cette approche permet de passer d’une analyse descriptive dynamique à une analyse plus anticipative, permettant aux banques centrales d’agir à l’avance.
Comment et dans quelles mesures la contribution des conditions financières d’aujourd’hui contribuera-elle à la croissance de demain ?
Pour cela, on utilise une mesure répandue aux Etats-Unis comme en Europe, la croissance à risque (GaR, Growth at risk). Utilisée par le Fond Monétaire International (FMI) dans son évaluation semestrielle du système financier mondial et créé par Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du Département des marchés monétaires et capitaux au FMI, cet outil permet de quantifier l’impact du risque financiers systémiques (systémique désigne le fait qu’un déséquilibre ici financier peut mettre en péril l’ensemble de l’économie, et ne se cloisonne pas aux marchés financiers).
Le GaR, en simulant des prévisions sur toutes les situations possibles dans l’économie, même les plus extrêmes, rend possible l’analyse des principaux moteurs de la croissance future du PIB, et ce, en fonction des différents scénarios.
L’exemple de l’utilisation du GaR s’illustre parfaitement avec la crise de 2008. Au premier trimestre 2008, l’Europe est entrée dans un récessions profonde. Le PIB réel de la Zone euro a diminué de 5,5% entre 2009 et 2013, et les pertes d’emplois se sont élevés à 5,3 millions de personnes sur l’ensemble des secteurs économiques. Passée d’un choc financier à réel, l’éclatement de la bulle immobilière (premier trimestre 2009) aux Etat-Unis, et précédée par l’effondrement des prix des logements en 2007, la crise des subprimes s’est transmises aux pays européens et a muté vers une crise des dettes souveraines.
Le GaR, avec 5% d’erreurs possibles et mesuré au début de la crise des subprimes, a indiqué que la probabilité d’une croissance trimestrielle du PIB dans la Zone euro de moins de -0,5% était de 5% en 2010, et en effet cette année-là, le PIB européen était de + 1,7% par rapport à l’année précédente.
En 2012, le GaR de 5% a été relevé à -1,5%, reflétant le moment où la dégradation des notations souveraines par les agences de notation a entraîné une augmentation des taux obligataires en Europe, augmentant alors l’insolvabilité progressive des Etats. Fin 2013, le GaR était revenu à son niveau d’avant la crise.
Plus récemment, pour 2019, les mesures du GaR ont conclu que les risques à la baisse pour la croissance étaient très faibles. En effet, le GaR de 5% (avec une marge d’erreur de 5%) calculé par la Banque de France était proche de 0% au deuxième trimestre 2019. La continuité du programme d’assouplissement quantitatif de la BCE et la réduction des tensions commerciales ont été plus tolérantes. La croissance au quatrième trimestre 2019 du PIB mondial estimée avec cet instrument aurait atteint 2,5%, en ligne avec le chiffre réel qui est égal à 2,3%.
Concernant la situation actuelle, l’estimation du GaR prévoit une baisse de la croissance annuelle du PIB mondial de 2,4% en 2020. Au début, la croissance pourrait même être négative, avec une contraction de 3%. L’économie de la zone euro s’est en effet contractée au premier trimestre 2020 de 3,8% par rapport au trimestre précédent et de 3,3% par rapport à l’année précédente, mais grâce à des outils de prévision et sans une deuxième vague de coronavirus, elle pourrait suivre une rebond incertain de 5,8% en 2021.
Sources :
- “Quels risques financiers sur la croissance en zone euro ?” Bloc-note Éco billet n° 116 Banque de France
- “Un nouvel indice des conditions financières pour la zone euro” Bloc-note Éco billet n° 100 Banque de France
- The Term Structure of Growth-at-Risk” IMF WP 18/180
- “Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance” IMF WP 19/36