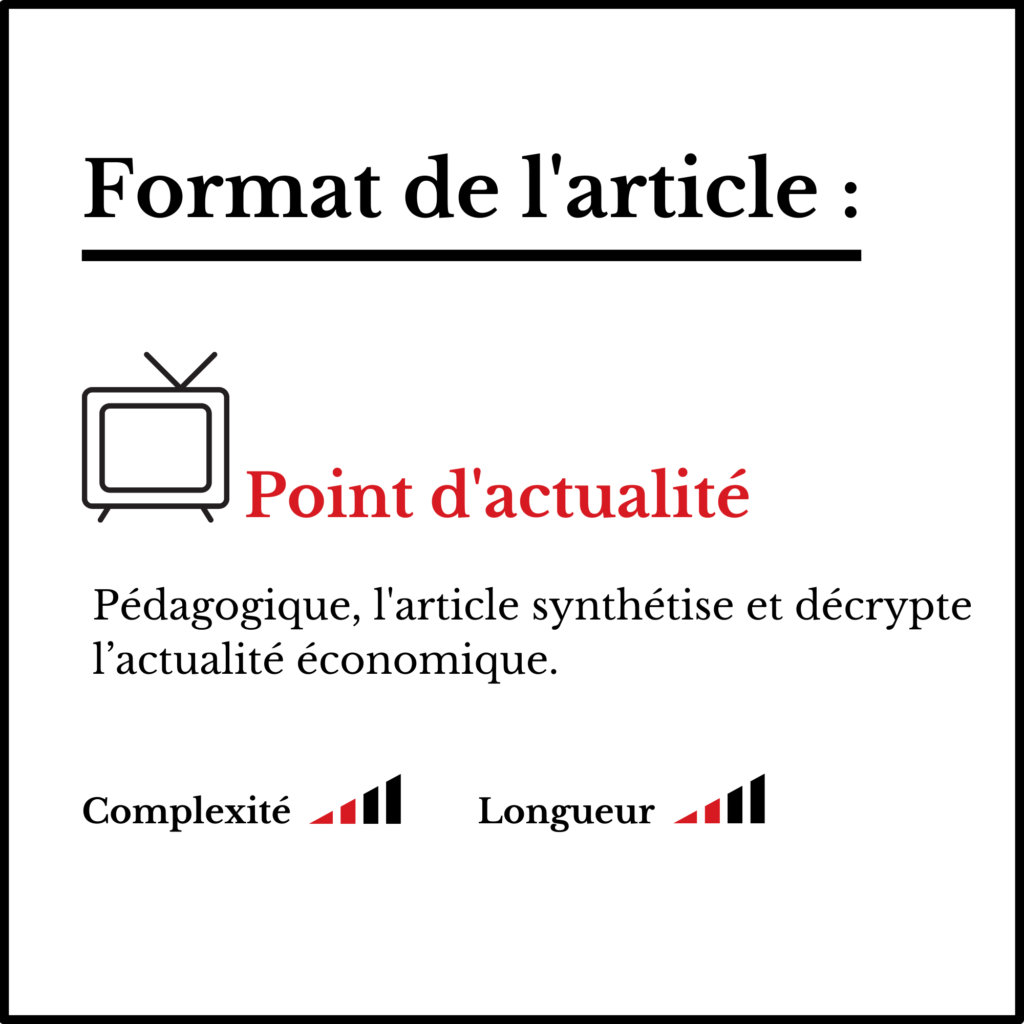
Xavier Jaravel a obtenu lundi dernier le prix du meilleur jeune économiste 2021. Ses travaux portent un regard sur les effets de l’innovation, de la robotisation ou de la politique monétaire sur la distribution des richesses. Il déconstruit certaines idées reçues: non les robots ne prennent pas nos emplois, non l’innovation ne bénéficie pas à tous et non la politique monétaire n’est pas neutre.
Chaque année, le journal Le Monde et le Cercle des économistes remettent le prix du meilleur jeune économiste. Ce prix récompense un ou une économiste dont les travaux sont (1) de grande qualité et (2) contribuent au débat public en matière économique. Ainsi, Thomas Piketty a reçu ce prestigieux prix en 2002 pour ses travaux sur les inégalités, Esther Duflo en 2005 et Pascaline Dupas en 2015 pour leurs travaux empiriques sur la pauvreté et le développement à partir d’essais randomisés ou encore Isabelle Méjean l’an passé pour ses travaux sur le commerce international et le concept de granularité (voir notre interview: (1)). Il faut désormais ajouter à cette liste de noms prestigieux celui de Xavier Jaravel. Il est devenu, lundi dernier, le meilleur jeune économiste de France 2021.
Xavier Jaravel commence l’économie sur les bancs de SciencesPo Paris. Il y obtient sa licence en économie et sciences politiques en 2011, classé summa cum laude. Il rejoint ensuite l’université Harvard aux États-Unis pour y faire son master et son doctorat. Il y soutient en 2016 sa thèse: Essays in the Economics of Innovation, écrite sous la direction de l’économiste Raj Chetty, titulaire de la prestigieuse médaille John Bates Clark. Après avoir été assistant professeur à l’université Harvard, il a rejoint en 2020 la London School of Economics.
Les travaux de Xavier Jaravel sont avant tout des travaux empiriques: peu de modèles théoriques et beaucoup d’analyses de données statistiques. Le lecteur qui n’a pas d’atomes particulièrement crochus avec les mathématiques aura sans doute du mal à lire les articles écrits et coécrits par celui qui succède à Isabelle Méjean.
L’un de ses articles les plus marquants est à l’origine le chapitre premier de sa thèse de doctorat. Il a ensuite été publié en 2019 dans le Quarterly Journal of Economics sous le titre: The Unequal Gains from Product Innovations Evidence from the US Retail Sector (2). Il y bat en brèche l’idée selon laquelle tout le monde bénéficierait des innovations de manière plus ou moins égale. En effet, après avoir séduit les plus riches qui peuvent s’acheter ladite innovation, elle se démocratise et l’ensemble de la population en bénéficie: ce fut le cas du vélo, de la voiture, des montres ou encore des livres. Cette théorie (dessinée ici à très gros traits) est connue sous le nom de cycle du produit, ou product cycle en anglais.
Dans l’article précédemment cité, Xavier Jaravel montre que les innovations créent des inégalités et ne bénéficient pas à l’ensemble de la population comme l’aurait prédit la théorie du cycle du produit. Evidemment que le progrès n’est pas égalitaire, pourrait-on penser, il suffirait de regarder la vie de Stéphane Bancel ou Eric Yuan. Le premier est PDG de l’entreprise pharmaceutique Moderna, et millionnaire depuis l’an dernier. Le second est le développeur de l’application Zoom, et sa fortune a plus que quadruplé entre janvier et septembre 2020 avec le confinement dû à la pandémie. Mais de tels exemples ne nous disent somme toute pas grand chose si ce n’est que ces deux hommes ont eu de la chance, et ces deux cas ne sauraient illustrer une montée des inégalités dues aux innovations.
La thèse soutenue par le jeune professeur de la London School of Economics est la suivante: avec la financiarisation de l’économie ou les allègements d’impôts pour les classes les plus riches, les inégalités de revenu augmentent dans plusieurs pays du monde. De plus, les salaires des plus riches augmentent plus vite que les salaires des plus pauvres. La demande par les consommateurs les plus aisés augmente donc plus vite que la demande par les consommateurs les plus pauvres. Autrement dit, les plus riches forment un marché plus dynamique et intéressant que les plus pauvres. Les entreprises ont donc intérêt à concentrer leurs efforts en direction des produits commercialisés à ces classes là. Et plus d’entreprises vont se spécialiser dans les biens et services à destinations des catégories en haut de l’échelle des revenus. Plus de produits substituables et plus d’entreprises en compétition sur un marché, cela engendre une compétition plus forte et donc des prix plus bas. En conséquence, les prix des produits consommés par les plus riches augmentent moins vite que les prix des biens et services consommés en bas de l’échelle des revenus. Le pouvoir d’achat des plus riches en sort grandi, celui des plus pauvres rétréci. Ainsi les efforts d’innovations tendent à bénéficier aux riches plus qu’aux pauvres.
Dans ce même article, Xavier Jaravel conclut que cette inflation liée à l’innovation correspond à près de la moitié de l’inégalité d’inflation observée. La même année, il signe d’ailleurs une note de politique publique pour le centre d’études sur la pauvreté et la politique sociale de l’université Columbia de New York. Cette note porte sur le concept d’inégalité d’inflation mentionnée ci-dessus. En effet, lorsque les prix augmentent mais que le salaire nominal reste identique, les salaires réels et le pouvoir d’achat diminuent. Si les prix des homards ou du caviar augmentent, ceux qui en consomment le plus verront leur pouvoir d’achat diminuer par rapport à ceux qui n’en consomment jamais. A l’inverse, si les produits de marque distributeurs subissent une forte inflation, alors le pouvoir d’achat des consommateurs de ces produits diminue.
Or, cette inégalité d’inflation n’est pas toujours prise en compte lors des calculs sur la pauvreté. D’ailleurs l’on parle du taux d’inflation, au singulier, alors qu’il n’est pas identique pour tous les produits et donc varie pour les différents schémas de consommation. En en tenant compte, on observe que le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté aux États-Unis est bien plus important que celui donné habituellement: près de 3 millions d’Américains rejoindraient donc les rangs des “pauvres”. De surcroît, on observe que les salaires sont plus rigides dans les secteurs où travaillent les personnes les plus qualifiées et les prix sont plus rigides dans les secteurs qui produisent à destination des personnes les plus qualifiées (par exemple, les produits haut de gamme). Or plusieurs travaux comme ceux d’Ivan Werning (3) ont conclu que l’on bénéficiait plus d’une politique monétaire lorsque l’on travaillait pour un secteur ou lorsque l’on consommait les produits d’un secteur avec des prix et salaires rigides. Ainsi, la politique monétaire aurait tendance à favoriser les personnes les plus qualifiées, alors même que ce n’était pas le but visé.
Cette question de la distribution des richesses traverse l’ensemble des travaux de Xavier Jaravel. A travers ce filtre, il a notamment jeté un œil aux effets du commerce international sur la distribution des richesses. Dans la théorie classique et surtout la théorie néoclassique, l’ouverture au commerce est bénéfique à l’économie en général mais aussi à chaque membre de la société (4). Depuis que les modèles canoniques du commerce intègrent la possibilité d’agents hétérogènes, on comprend mieux les effets négatifs que peut avoir l’ouverture internationale sur certaines parties de la population. Dans nos pays occidentaux développés, le modèle Heckscher-Ohlin conclut que nous devrions nous spécialiser dans les biens intensifs en capital et en travail qualifié. Ainsi, les plus pauvres se verraient défavorisés. Plus précisément, dans leur article de 2018 Xavier Jaravel et Kirill Borusyak distinguent deux canaux par lesquels l’ouverture au commerce influence la distribution des richesses: d’un côté les revenus et de l’autre les dépenses. Du côté des revenus, l’ouverture au commerce va défavoriser certaines classes, les vouant au chômage et réduisant ainsi leurs revenus. Ceci est bien plus vrai pour les personnes non-qualifiées que pour les personnes qualifiées. Du côté des dépenses, l’ouverture au commerce permet des prix plus bas pour les biens de consommation. Les gains de ces prix bas sont assez neutres d’un point de vue de la distribution des revenus: les riches consomment plus de services (qui ne sont pas impactés par l’ouverture internationale) mais aussi plus de biens technologiques importés (voitures de marques étrangères, matériel informatique, etc.). Ces deux éléments se contrebalancent et les riches ne bénéficient ni plus ni moins de prix affaiblis par la concurrence étrangère. En analysant empiriquement les dépenses et les entrées, on observe donc que l’ouverture au commerce est loin d’être neutre sur la distribution des richesses, comme le proclament certains chantres de la libéralisation du commerce.
Le tableau dressé jusqu’ici semble donc bien sombre pour les personnes moins qualifiées dans nos économies occidentales. En plus d’être plus sujettes à l’inflation, plus souvent victimes de l’ouverture au commerce, un troisième danger semble les menacer: la robotisation de l’économie. Fernand Braudel définissait le système capitaliste comme un régime économique dans lequel le capital est voué à devenir prépondérant au sein des processus de production. Quel meilleur exemple donc que l’automatisation de la production ! Dans l’imaginaire collectif, les machines et les robots remplacent donc les travailleurs et créeraient du chômage technologique. Ainsi, la part du travail chuterait au profit de la part du capital dans la valeur ajoutée. Or, il n’en est rien. La part des revenus du travail dans le revenu national reste constante. Mais la mécanisation de la production ne signifie pas la fin des emplois, ni même la fin des emplois non qualifiés. En effet, les machines remplacent certes la force de travail, mais permettent de gagner en productivité: un travailleur produit avec l’aide de machines plus de biens et services qu’auparavant. Par conséquent son salaire réel augmente: soit les prix des biens baissent pour un salaire nominal inchangé, soit les prix restent inchangés et dans ce cas le salaire réel augmente (5). Si les salaires augmentent, notamment chez les personnels moins qualifiés, alors la demande augmente (et proportionnellement plus encore chez les moins qualifiés, donc moins riches). Et puisque la demande augmente, les entreprises vont devoir produire plus et embaucher car les machines ne peuvent pas tout faire sans humains pour les conduire.
Sources
- https://oeconomicus.fr/tout-relocaliser-nest-pas-possible-conversation-avec-isabelle-mejean/
- Jaravel X. 2019. “The Unequal Gains from Product Innovations: Evidence from the US Retail Sector”. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 134, No. 2, pp. 715-783.
- Werning, I. 2015. Incomplete markets and aggregate demand. Technical report, National Bureau of Economic Research.
- Pour être exact, il peut être intéressant de se rappeler quelques éléments d’histoire de la pensée économique. Pour les mercantilistes, l’ouverture au commerce n’est bénéfique que si l’on exporte plus que l’on importe. Chez les classiques (Smith, Ricardo, etc.), l’ouverture au commerce bénéficie à l’ensemble de l’économie grâce aux gains de productivité, même en cas de balance défavorable du commerce. En revanche, rien n’assure que ces gains soient répartis équitablement, et rien n’assure non plus que personne ne perde. En revanche, chez les néoclassiques, et principalement dans les modèles canoniques du commerce international, basés sur un individu représentatif, les gains bénéficient à l’ensemble de l’économie et donc à chaque individu représentatif. Bien sûr, des modèles néoclassiques avec des agents hétérogènes ont pu être développés, mais bien tardivement…
- Pour les esprits les plus rigoureux, il faudrait préciser qu’on raisonne ceteris paribus, autrement dit, on suppose que le taux de profit n’a pas augmenté de façon à absorber la plus grande valeur ajoutée produite par les travailleurs aidés de machines






